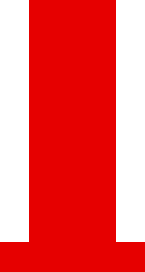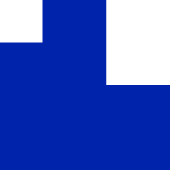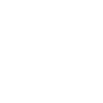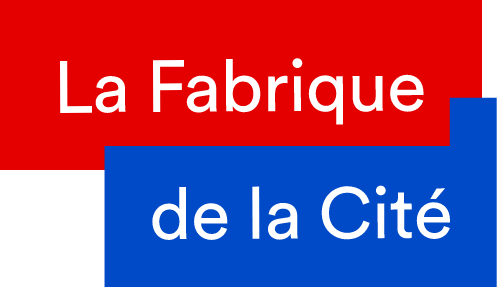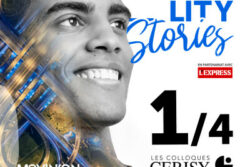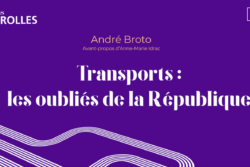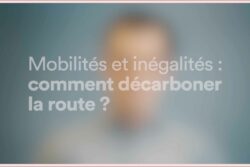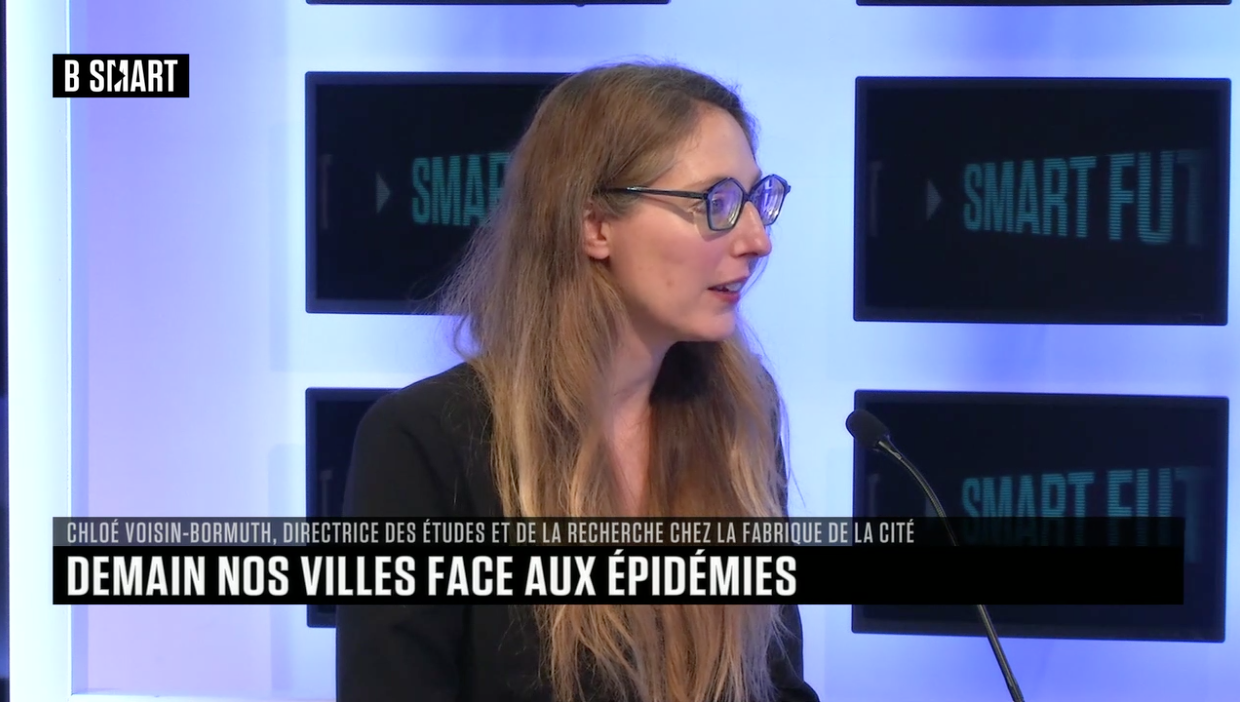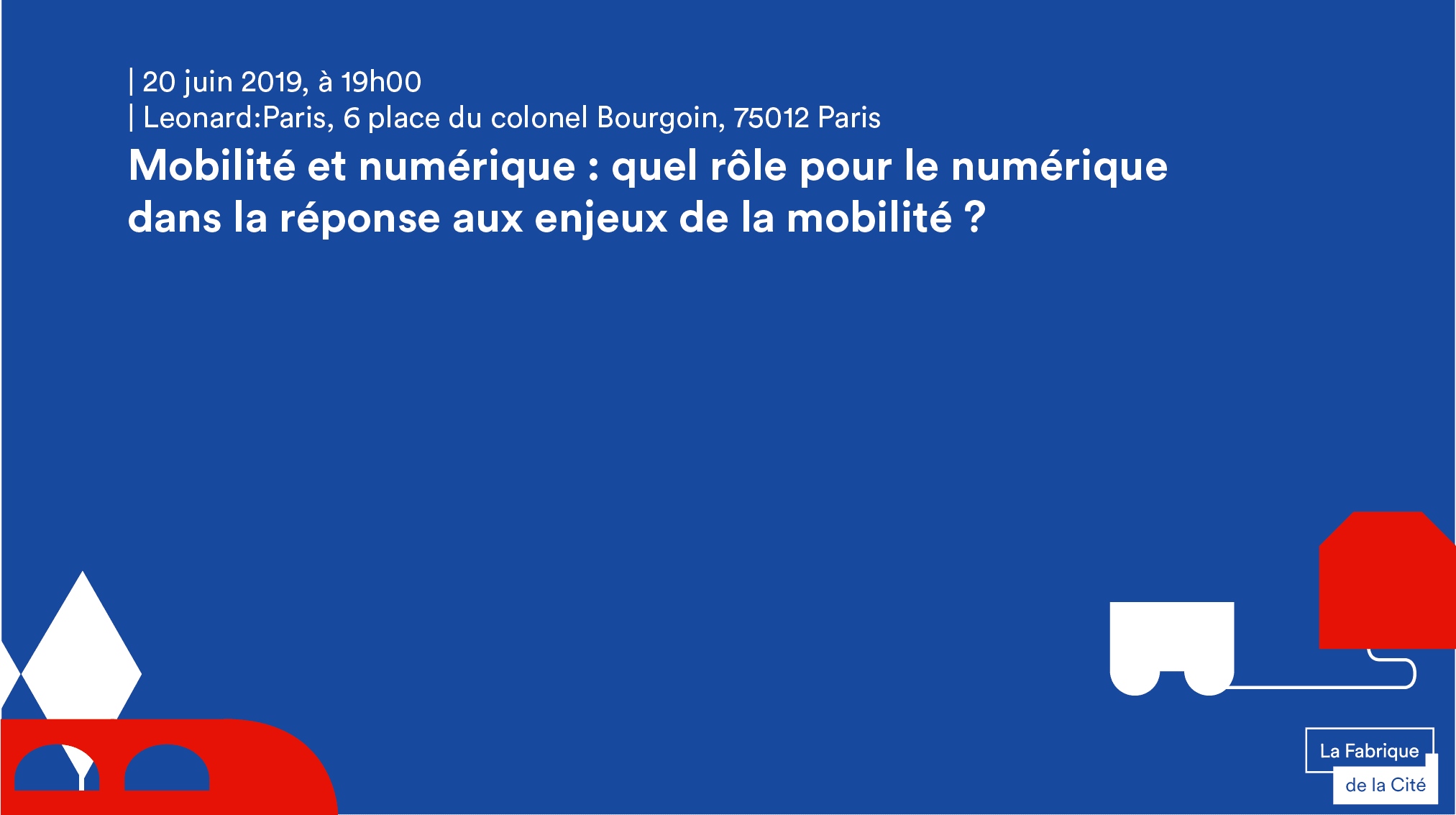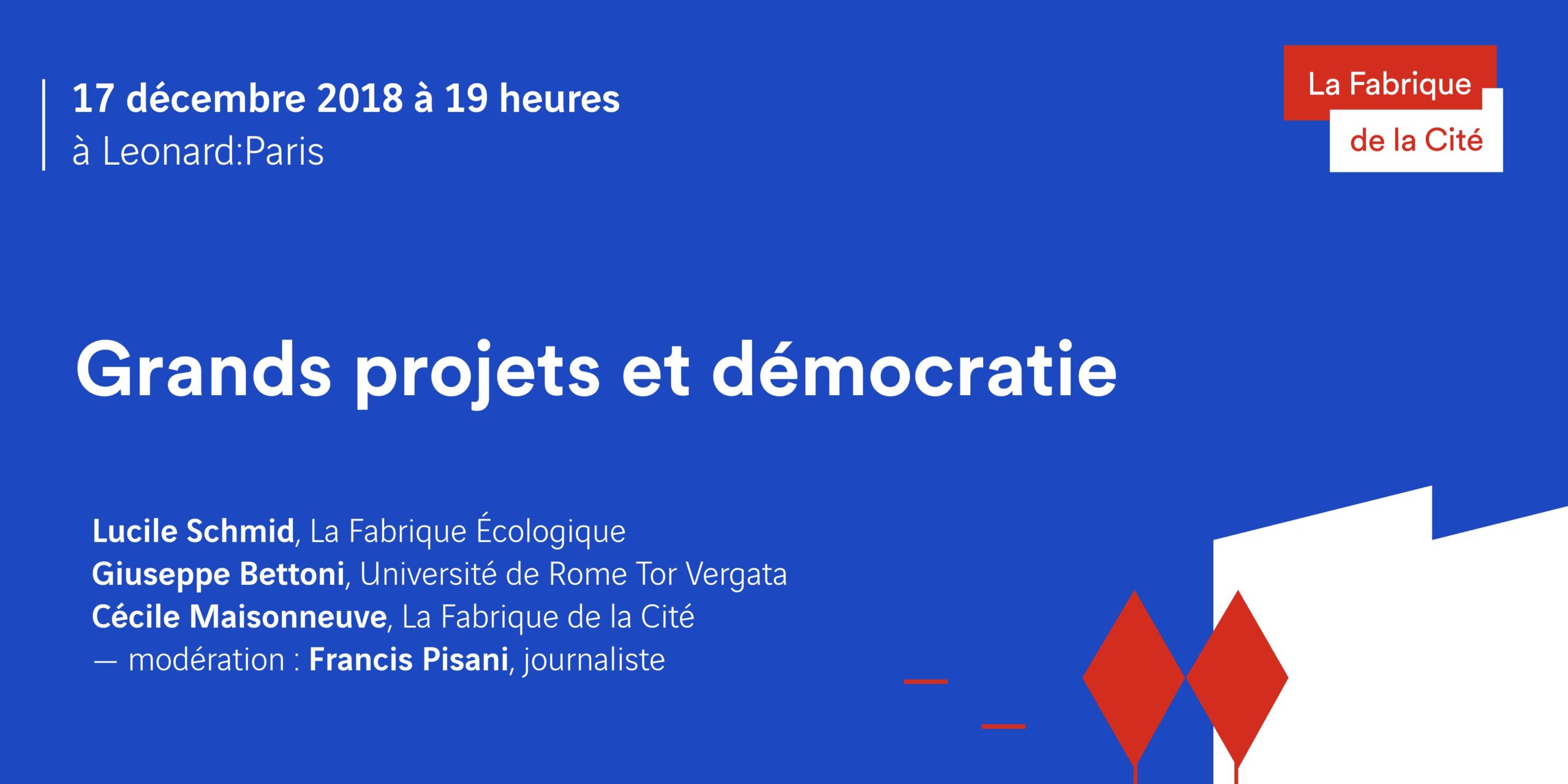Colloque Décider maintenant « Quel avenir pour nos infrastructures de transport ? »
Céline Acharian, directrice générale de La Fabrique de la Cité et Anthony Briant, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), ont introduit le colloque en dressant un panorama des enjeux économiques, sociaux et environnementaux des infrastructures de transport. Céline Acharian a rappelé le besoin de moderniser le million de kilomètres de routes, dont 700 000 km de routes communales, les 8 500 km de voies navigables et les 30 000 km de voies ferrées face à l’intensification des crues, inondations, sécheresses et pour décarboner les mobilités. Ce qui demande de réinterroger le jeu d’acteurs. Faisant référence au sommet sur l’IA en cours en France, Anthony Briant rappelle que si l’IA peut trouver une place dans « nos métiers ». Selon lui, l’avenir sera difficile sans des infrastructures physiques en bon état. Il faut, selon lui, en faire des atouts, des leviers de la transformation.
« Les mobilités changent et les infrastructures doivent s’adapter. »

La France est-elle un bon élève à l’échelle de l’Europe et du monde ? C’est une des questions posées à Federico Antoniazzi, directeur du mastère spécialisé Systèmes de transports ferroviaires à l’ENPC. Les trois modes de transports terrestres – routier, ferroviaire, fluvial – font face à un sous-investissement chronique avec néanmoins des particularités (le réseau autoroutier est par exemple en très bon état). Par ailleurs, la France investit 4,3 % de son PIB dans les infrastructures, contre une moyenne de 3,4 % pour l’UE. Les besoins sont par conséquent d’autant plus importants (de l’ordre de 60 à 130 milliards d’euros d’ici à 2040 selon le COI) que les changements climatiques s’intensifient. Pour lui, la priorité doit se porter sur l’intermodalité au quotidien, notamment via les Services express régionaux métropolitains (SERM) puisque l’offre est insuffisante dans le périurbain. Une question subsiste : comment financer la transition quand la fiscalité repose en partie sur les énergies fossiles et sur le versement mobilité des entreprises ?
Quelles sont les perspectives pour les infrastructures de transport ?
L’état des infrastructures de transports françaises est globalement assez préoccupant. Alexandre Rouffignac, délégué général de Routes de France, rappelle les constats d’un audit commandé par le ministère de la Transition écologique et d’un rapport de la Cour des Comptes de 2022 : les routes se dégradent, souffrent d’un sous-investissement et près de 50 % du réseau routier est considéré en mauvais état.
« 1€ qui n’est pas investi aujourd’hui dans les infrastructures routières, c’est 6 à 8€ qui devront être investis dans 30 ans. »

Ce constat est partagé par Béatrice Agamennone, directrice Grand-Est du Cerema et vice-présidente de Metz Métropole : d’après les travaux du Cerema sur l’état des ponts, un tiers des 200 000 à 250 000 ponts français est en très mauvais état. Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, constate que quand bien même les infrastructures peuvent être dans un état satisfaisant, les projections climatiques révèlent de fortes vulnérabilités du réseau face aux risques à horizon 2050. D’où le besoin d’adopter une démarche proactive.
Alors, comment conjuguer ces observations avec les nouveaux défis de la transition écologique ?
Antoine Comte-Bellot, directeur de programme au Secrétariat Général à la Planification Écologique, présente la prospective de l’évolution de la part modale de chaque mode de transport du SGPE, pour aider à prioriser les investissements. Par exemple, les transports de passagers et de marchandises étant destinés à rester massivement routiers à horizon 2030 et 2050, ces infrastructures doivent être entretenues et adaptées au réchauffement climatique, aux risques incendie, inondation et aux enjeux de préservation de la biodiversité.
« Il y a un enjeu significatif d’investissement pour proposer une nouvelle offre de transport. »
Une fois ce constat établi, quelles implications en matière de politiques publiques ?
Le département de la Haute-Garonne a conduit, avec le Cerema, un diagnostic de ses vulnérabilités pour identifier les points d’attention sur les infrastructures de transport. Routes de France a par ailleurs travaillé à la conception d’un outil, Infraclimat, qui identifie les vulnérabilités des infrastructures face aux changements climatiques. Béatrice Agamennone souligne la nécessité d’une vision territoriale pour répondre à ces défis et garantir les mobilités du quotidien. À ce sujet, les projets SERM approfondissent le travail partenarial en matière d’investissement dans les transports, même si la temporalité de ces projets peut devenir un facteur ralentissant l’action… L’investissement supplémentaire à prévoir devra probablement être compensé par une réduction de nouveaux projets, mais l’offre doit continuer à augmenter pour répondre aux besoins de mobilité de tous, rappelle Antoine Comte-Bellot. Les solutions, telles que la sobriété, le réemploi, le changement modal, sont autant de leviers complexes à activer. À ce titre, une volonté et un portage politique forts sont perçus comme indispensables.
Quels choix d’aménagement et quels financements pour des infrastructures durables ?
Au regard de ces enjeux, l’état des infrastructures de transport est bien au cœur de la transition écologique. Benoît Thirion, avocat associé chez Hoche Avocats, rappelle qu’elles sont responsables de 30 % de l’artificialisation des sols[1] et que 50 % de l’empreinte carbone de la France est liée à leur usage. À ce titre, les investissements pour les décarboner, les régénérer et les moderniser sont cruciaux. En 2030, les besoins supplémentaires par an sont estimés entre 35 et 65 milliards d’euros. Gérard Leseul, député de la 5ème circonscription de Seine-Maritime a spécifié les enjeux des infrastructures fluviales : des financements qui doivent permettre le report modal d’une partie du fret et l’amélioration des équipements pour éviter les inondations.
Il appelle alors au développement et au renforcement du rôle de l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFIT) dont la stabilité a été remise en question dernièrement. Il faut qu’elle puisse jouer son rôle d’opérateur national. La mobilisation de l’épargne populaire est une piste évoquée à l’Assemblée nationale, mais qui peine à avancer.
[1] D’après un rapport de Terra Nova paru en novembre 2024.

« La puissance publique doit être l’opérateur premier, mais pas forcément l’opérateur unique. Il existe des modes de financement complémentaires au financement public. »
Valérie Vesque-Jeancard, présidente de VINCI Railways et directrice déléguée de VINCI Airports, dresse un parallèle entre le mur d’investissement et les besoins du réseau ferroviaire au début des années 2000. La puissance publique avait alors eu recours à des outils tels que les partenariats public-privé (PPP) et la concession, permettant de ne pas peser sur les budgets de l’État tout en multipliant les capacités de financement, donnant aussi aux concessionnaires le temps nécessaire pour innover.
Le financement des infrastructures est d’autant plus complexe que le réchauffement climatique pèse sur la conception des projets, rappelle Inouk Moncorgé, directeur d’investissement chez Meridiam. Il peut impacter la qualité, le coût et le délai – les trois paramètres de réussite d’un projet d’infrastructure. Toutefois, si les délais pour investir ces fonds restent longs, les investisseurs s’intéressent à ces projets : les levées de fonds se font sans difficulté.

Julien Villalongue, directeur de Leonard, a conclu la matinée par une mise en perspective de ces enjeux. Si l’IA peut amener des informations significatives pour l’adaptation de nos réseaux, il a rappelé que 20 % de notre consommation électrique est destinée aux data centers et cette part ne cesse d’augmenter. Et alors que des multinationales voient leur empreinte carbone exploser avec leur utilisation de l’IA, comment poursuivre nos efforts pour décarboner nos économies ? La décennie qui nous attend est une décennie de régénération, de transformation profonde des infrastructures. Alors soyons innovants, créatifs, ambitieux et optimistes !
Rendez-vous le 22 mai pour le prochain colloque Décider maintenant dédié à l’électrification des infrastructures de transport !
Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Jour 4 : La route, un espace commun ?

Jour 3 : « En route »

Jour 5 : Les imaginaires de la route

Jour 1 : La route au cœur du patrimoine français

Jour 2 : La bataille de la route : la route face aux défis environnementaux

« Et si le monument le plus durable était justement la route ? » Aurélien Bellanger
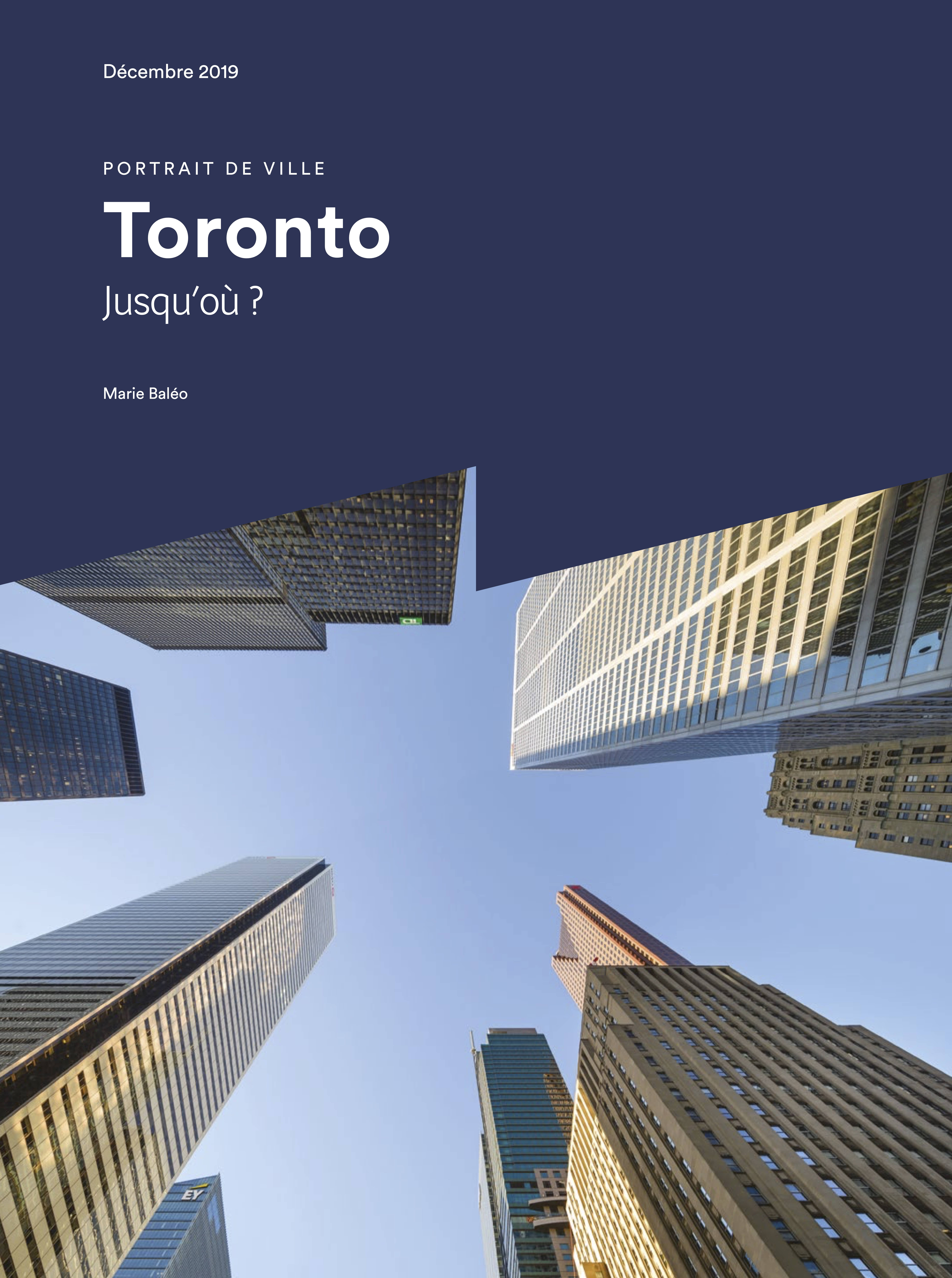
Toronto : jusqu’où ?

« Dig, baby, dig »

Les villes, des mines d’or qui s’ignorent ?
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.