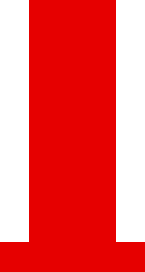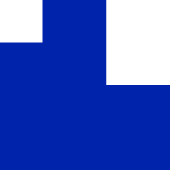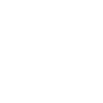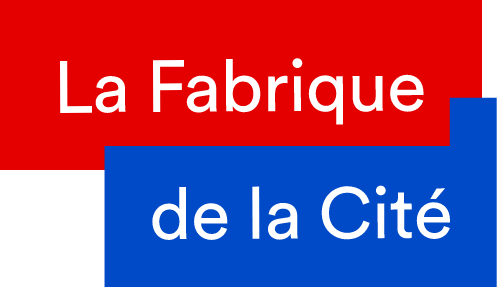Vœux 2025
« Nous avons la ferme conviction que la ville est césure, rupture et destin du monde. »
C’est par cette conviction réaffirmée que Céline Acharian, directrice générale de La Fabrique de la Cité a débuté la cérémonie de vœux 2025 de Leonard et de La Fabrique de la Cité.
En 2025, La Fabrique de la Cité continuera de prendre en compte à la fois « la temporalité de la recherche longue et la temporalité de la décision » pour garder la rigueur nécessaire à la passion qui anime son travail : le destin des villes.
Deux grandes questions structureront ainsi le programme d’études 2025 de La Fabrique de la Cité :
Comment préserver la qualité de vie en ville à l’heure du changement climatique ?
Pour évaluer l’impact de nos espaces de vie urbains sur notre santé et notre confort quotidien, La Fabrique de la Cité mènera des travaux sur le rafraîchissement urbain, les bruits en ville, la qualité des sols, la renaturation et les espaces interstitiels, notamment les friches tertiaires et industrielles.
Quelles méthodes, quelle révolution du regard et des pratiques adopter pour concevoir la ville de demain ?
Les plans adaptation incendies, la géothermie, la résilience des infrastructures, l’évolution des mobilités ou encore les impacts des politiques de réindustrialisation seront, cette année, au cœur de nos études et articles pour proposer des pistes de réflexions méthodologiques aux enjeux des transitions urbaines
Ces deux questions clés seront évoquées, comme les années passées, à travers le prisme des villes moyennes, dans lesquelles La Fabrique de la Cité continuera de vous donner rendez-vous pour des ateliers territoriaux et pour la 6e édition des Rencontres des Villes Moyennes, mais aussi via des exemples de métropoles étrangères, notamment Venise, qui fera l’objet d’un portrait de ville en 2025.

Ces vœux ont également été l’occasion d’évoquer la question des ressources, thème de la prochaine édition du festival Building Beyond, qui se tiendra les 13, 14 et 15 mai prochains.
Aristide Athanassiadis, enseignant-chercheur et créateur du podcast Metabolism of Cities, a expliqué en introduction que le déplacement de la production agricole à l’extérieur des villes a refaçonné la gestion de l’eau, des sols et de la biodiversité. Au 19e siècle, la ville avait un fonctionnement très circulaire. Les aménageurs et décideurs ont progressivement rendu le système de gestion des ressources très linéaire, en mettant fin à l’activité de réemploi de certaines professions, comme les chiffonniers, ou encore en systématisant l’utilisation du tout-à-l’égout.
« À l’époque, au 19e siècle, nous avons construit les infrastructures comme si elles étaient éternelles, or chaque époque est confrontée à de nouveaux problèmes. »
À cette grande linéarisation a succédé une grande accélération. De plus en plus d’infrastructures ont linéarisé les flux. Aujourd’hui nous avons hérité de ces infrastructures qui nous obligent à trop polluer et à trop consommer, et cela nous impose de penser de nouvelles infrastructures plus circulaires et moins consommatrices de ressources.
« Face à un nouveau contexte, comme on peut le voir à Valence et ou à Los Angeles, reconstruire les mêmes infrastructures n’est peut-être pas la meilleure solution. »

Dominique Jakob, architecte, co-fondatrice de l’agence Jakob+MacFarlane, co-commissaire du Pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise 2025 a mis en évidence l’enjeu crucial de la disponibilité et de l’accès aux ressources. Il convient aujourd’hui d’adapter nos pratiques en fonction des ressources disponibles, en s’inspirant des méthodes de microclimats. Dans des zones désertiques, il est ainsi possible de créer des micro-zones humides et une circularité de l’air pour rafraichir les espaces. Les aménagements peuvent intégrer des schémas environnementaux différents permettant d’intégrer plus de circularité, par exemple, en récupérant les eaux grises pour alimenter les jardins.
« C’est à nous d’ouvrir les yeux, de trouver, de sourcer les ressources, de voir celles qui sont le plus proche de nous, et comment faire avec ce qu’on a. »
Christian Piel, urbaniste et hydrologue, fondateur du bureau d’études Urban Water a rappelé l’importance du cycle de l’eau en milieu urbain. Il faut, à la fois, gérer les pluies exceptionnelles et les petites pluies pour favoriser l’infiltration des eaux et recharger les nappes phréatiques. En favorisant le ruissellement, l’excès d’eau peut parfois devenir une ressource et amorcer un cercle vertueux. Le rôle des urbanistes est alors de se rendre sur le terrain pour étudier les aménagements favorables au cycle de l’eau sur tous leurs projets.
« Préserver la ressource en eau c’est aussi préserver quelque chose qui n’était plus une ressource : les sols. Remettre de l’eau en ville permet de réactiver les sols, la végétation et les services rendus par la nature. »
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.