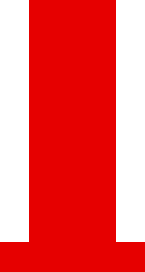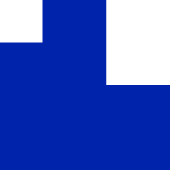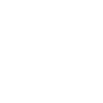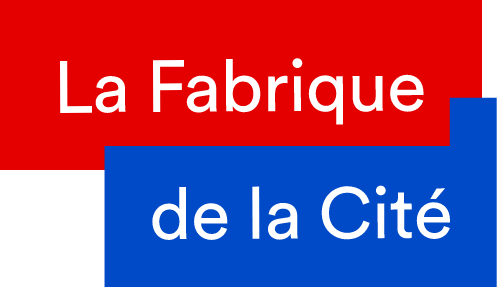« Notre rapport à la nature est très aseptisé. On veut renaturer, mais on aspire à une nature qui ne s’entretient pas, qui ne pique pas » Loéna Trouvé
La Fabrique de la Cité : Comment le Cerema aborde le rôle et le potentiel des cours d’école avec les collectivités qu’il accompagne ?
Loéna Trouvé : Le Cerema s’est positionné sur le sujet dès 2019, dans le cadre de travaux avec les collectivités autour des Solutions fondées sur la Nature. Les cours d’école apparurent alors rapidement comme un levier d’adaptation à privilégier. Ce sont bien souvent des espaces emblématiques pour les communes, qui véhiculent des représentations positives et favorisent l’implication politique et l’expérimentation. Aujourd’hui, le sujet est de plus en plus médiatisé, mais la tentation de calquer les projets sur quelques exemples très emblématiques peut compromettre leur réussite. Sur des projets aussi connus que les cours Oasis parisiennes, les réalisations ont beaucoup évolué entre les premières cours livrées et celles qui le sont aujourd’hui. Reproduire ce qui a bien fonctionné ailleurs, c’est aussi s’exposer au risque d’une mal-adaptation et d’une inadéquation avec le contexte unique de chaque cour.
Le Cerema, en tant que centre de ressource et d’expertise, propose alors un accompagnement multidimensionnel et sur-mesure aux collectivités intéressées par ce sujet – sur les approches technique, patrimoniale, la gestion des eaux, le choix des matériaux – pour établir un diagnostic technique complet et ajuster les objectifs en fonction des moyens et des besoins. Nous préconisons une méthode qui part des usages de l’espace, via des démarches de participation. Elles rassemblent les personnels enseignants, les élèves, les agents périscolaires et d’entretien, les parents d’élèves, etc. Concerter l’ensemble des publics qui ont affaire à la cour de récréation ou la fréquentent permet d’avoir une boussole précise et ainsi d’intégrer la transversalité dès la conception du projet.
Cette démarche est d’autant plus importante que toutes les villes ne connaissent pas les mêmes enjeux et que, même à l’échelle d’une ville, toutes les écoles n’ont pas les mêmes besoins. Par exemple en matière de gestion des eaux pluviales, une école à Vénissieux a une cour dans laquelle le sol est tellement compacté qu’il est complètement imperméable, et dès qu’il pleut, il n’est plus possible d’aller en récréation. Cette situation peut être différente dans une autre école de la même commune. De la même manière, si les aménagements d’une cour sont complètement vétustes ou si les jeux y sont inexistants, l’intervention sera différente que dans une cour avec des jeux et des espaces encore en bon état.
LFDLC : On comprend que la végétalisation des cours d’école peut répondre à une série assez large de besoins, entre qualité des espaces de jeux, gestion des eaux de pluie et surchauffe urbaine. Quelles sont plus spécifiquement les priorités des collectivités sur ces projets ?
L.T. : Les principales motivations des collectivités pour intervenir sur ces espaces sont en effet la question de l’eau, de la surchauffe urbaine, mais aussi souvent une urgence à rénover le patrimoine scolaire. Selon la volonté des élus, la rénovation du bâti peut être l’occasion de repenser les espaces extérieurs. On essaie alors d’inviter les communes à adopter une approche transversale entre le bâti, la cour et les abords, et ce, dès le diagnostic. Le lien entre l’école et le reste du tissu urbain est à repenser : si se trouve non loin de l’école un parvis sécurisé ou un parc, des séquences peuvent être organisées dans ces espaces. Un parvis peut être végétalisé, un cheminement sécurisé vers le parc peut être aménagé, et permettre ainsi d’avoir accès à de la nature sans forcément passer par une intervention sur la cour. Le Cerema a dans son ADN la transversalité et permet aux acteurs de voir, au-delà de la cour, la cohérence de l’espace urbain.
La multiplication des événements climatiques extrêmes conduit à s’interroger sur le potentiel rafraîchissant de ces espaces-là. Le Cerema conduit des études sur le sujet, notamment avec la ville de Libourne sur sa stratégie de végétalisation. Des capteurs ont été posés et un travail de modélisation est en cours pour étudier les variations de température dans le temps, et ainsi proposer des recommandations dynamiques. Une étude est également en cours sur le périmètre de la communauté européenne d’Alsace, sur les cours de collèges, qui va suivre les données climatiques en amont, pendant et après les travaux qui vont être effectués sur les cours.
LFDLC : Comment le réaménagement des cours d’école peut permettre le retour de la nature en ville ? Est-ce que les surfaces sont suffisantes pour que leur renaturation ait des effets significatifs ?
L.T. : La végétalisation des cours est un levier essentiel pour l’adaptation aux changements climatiques, mais aussi pour faire face à l’érosion de la biodiversité. Le moindre mètre carré de pelouse entretenue de manière favorable au retour de la biodiversité est crucial. La moindre haie qui peut servir d’habitat pour les oiseaux est non-négligeable. Au-delà du rôle symbolique que peuvent remplir les cours, elles peuvent jouer un vrai rôle pour la survie et l’habitat de la petite faune urbaine. Les cours ont aussi bien sûr un rôle de sensibilisation, qui est significative. Pour les enfants, des cours végétalisées permettent la compréhension du vivant, mais favorisent aussi le bien-être mental et leur développement cognitif.
LFDLC : Quels obstacles et verrous à lever identifiez-vous à la généralisation et massification des démarches de renaturation ?
L.T. : Le principal obstacle est notre rapport très aseptisé à la nature. On veut renaturer, mais on aspire à une nature qui ne s’entretient pas, qui ne pique pas. Deux exemples qui illustrent bien ce rapport contemporain à la nature : le lierre et l’ortie. Le lierre est une plante qui est très peu installée dans les espaces publics et plus spécifiquement dans les cours d’école, en raison de sa toxicité si elle est ingérée en très grande quantité. Or les quantités qu’il faudrait ingérer pour que ce soit dangereux sont très conséquentes, encore plus pour des enfants. Le lierre est quand même banni des cours d’école, alors que c’est une des plantes grimpantes les plus intéressantes en termes de floraison. L’ortie est une plante qui pique quand on la touche effectivement, mais sauf en cas d’allergie avérée, la piqure d’ortie n’est pas dangereuse, et on peut considérer que cela fait aussi partie de l’apprentissage du vivant que de savoir qu’une plante pique, de connaître les manières de la toucher pour qu’elle ne pique pas, etc. Mais notre rapport à la nature est tel que l’on plante toujours les mêmes espèces, qui ne sont pas forcément très intéressantes, dans les cours et les espaces verts.
Un autre frein peut résider dans la difficulté à sortir des habitudes d’aménagement et à accepter de revenir sur certaines pratiques et réalisations. De nombreux espaces publics ont été refaits récemment, mais malheureusement ils ont souvent peu de végétation et sont globalement très imperméables. Le fait de revenir en arrière et d’intervenir de nouveau sur un espace pour défaire ce qu’on a fait il y a quelques années est difficile à porter politiquement. Cette problématique se retrouve même sur des quartiers labellisés Écoquartier, conçus il y a quinze ans et livrés il y a cinq ans. L’inertie des aménagements publics cause des situations qui peuvent paraître complètement aberrantes. Des solutions temporaires telles que des plantes en pot, ou des voiles d’ombrage peuvent permettre de rafraîchir des espaces sans forcément demander de tout refaire. Néanmoins, il faut que les pratiques des assistances à maîtrise d’ouvrage et d’usage adaptent leur boîte à outil et leur expertise pour conseiller au mieux les collectivités, et s’adapter aux pratiques de renaturation.
LFDLC : Comment percevez-vous l’évolution de l’intérêt autour du sujet ?
L.T. : Il me semble qu’au-delà de l’effet de mode, le sujet ne fait que prendre de l’ampleur. La communauté que nous animons sur ce sujet, « Écoles de demain », fonctionne très bien. Beaucoup d’organismes se saisissent de ce sujet, comme les agences de l’eau ; l’axe « Renaturation » du Fonds Vert a été beaucoup sollicité sur des végétalisations de cours d’école. C’est un espace qui permet d’expérimenter, d’envisager la mise en place d’espaces refuges climatiques, de questionner l’intensification des usages, le design actif, l’urbanisme favorable à la santé ou encore la ville à hauteur d’enfants.
Interview réalisée par Marianne Laloy Borgna, chargée d’études de La Fabrique de La Cité.
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.