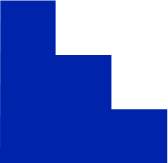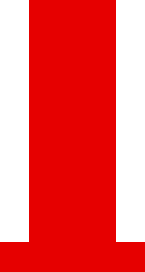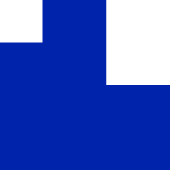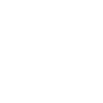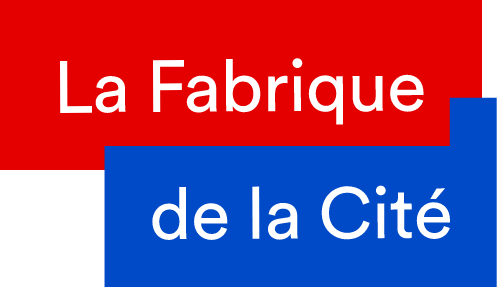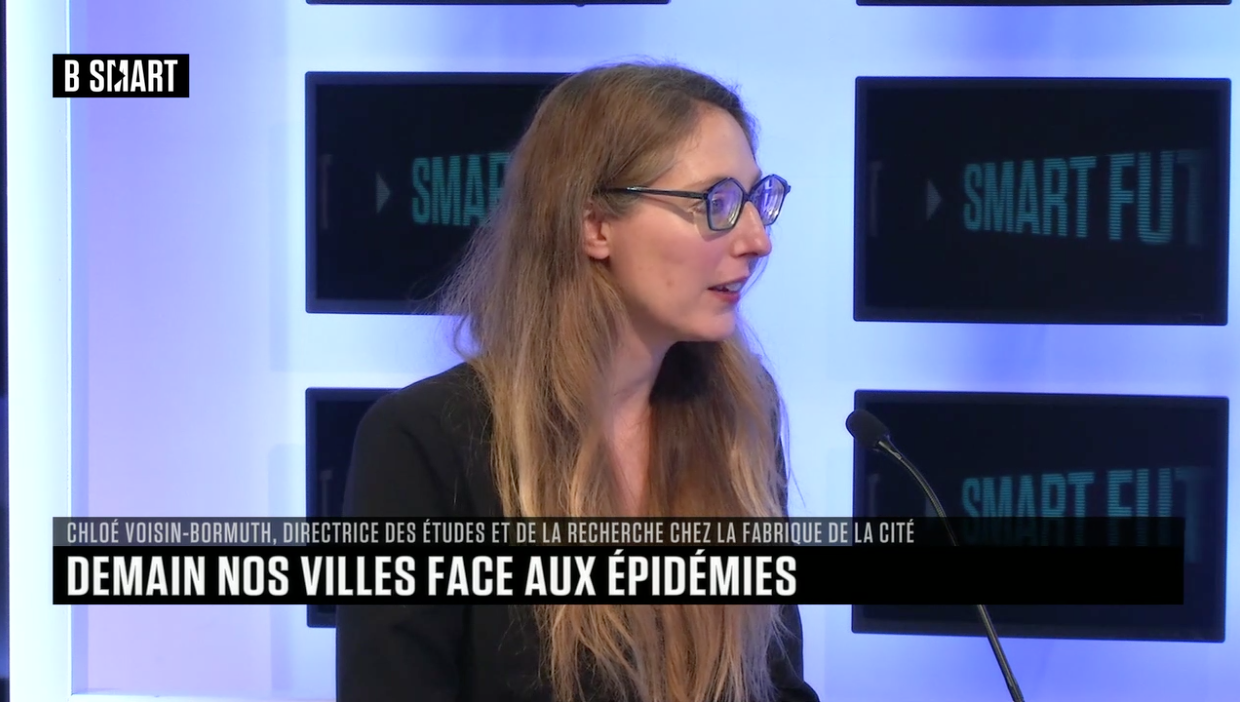Villa les pieds dans l’eau
« Traverser son jardin et accéder aux eaux turquoise de la mer Méditerranée, profitez d’un cadre exceptionnel et d’une vue imprenable sur la mer… » : ce que Sotheby’s International Realty exprime à travers ces mots, c’est que la villa au bord de l’eau reste une valeur immobilière sûre. Pour la France, les prix immobiliers en front de mer ont augmenté de 11,8% sur la côte atlantique entre 2017 et 2019 et de 12% sur la côte d’Azur. Parmi les raisons de cette hausse, l’engouement pour ce type de bien immobilier, bien sûr, puisqu’il correspond à un certain idéal de qualité de vie, mais aussi l’interdiction d’urbaniser sur une bande de 100 mètres à partir de la limite haute du rivage, inscrite dans la loi littoral. Or c’est bien connu : ce qui est rare est cher.
Mais c’est là que se trouve tout le paradoxe : si le littoral est protégé, c’est en en raison de sa fragilité et du risque d’érosion accéléré que fait peser l’urbanisation sur le trait de côte. L’érosion est un phénomène connu et prévisible : le Cerema a établi que qu’entre 5 000 et 50 000 logements seront potentiellement atteints en 2100 par le recul du littoral et que, pour certaines communes, les logements menacés concentreront plus de 10% des habitants. Par ailleurs, plus de 850 communes et 1,4 million d’habitants sont soumis au risque de submersion marine. En Chine, en 2100, 630 millions de personnes pourraient être concernées. Ces deux aléas, l’érosion et la submersion marine, sont aggravés par l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, évaluée à +3.2mm/an en moyenne depuis les années 1990. Ces changements environnementaux menacent donc directement des activités professionnelles, des infrastructures de transport, des réseaux, des équipements publics, des espaces naturels et des logements… dont les villas qui s’échangent à prix d’or et qui se retrouveront alors, littéralement, « les pieds dans l’eau ».
Si le marché immobilier ne reflète pas la réalité de l’exposition au risque des biens situés en front de mer, c’est essentiellement dû à deux faits : d’une part, l’horizon du péril reste trop lointain, à l’échelle d’une vie humaine, pour freiner la spéculation ; d’autre part, les stratégies adoptées pour faire face au risque se concentrent depuis le Moyen-Âge sur la protection et la construction d’ouvrages tels que les digues, les épis ou les brise-lames.
Éric Chaumillon, chercheur en géologie marine à l’Université d’Angers, montre toutefois que cette approche fondée sur la protection, si elle reste efficace et nécessaire, est aujourd’hui insuffisante : en 2100, le niveau de la mer aura augmenté au minimum de 43cm (si on atteint la neutralité carbone) et au maximum de 110cm. Les scénarios pessimistes font état d’une élévation de 3m en 2200. Peut-on continuer de se contenter d’élever des digues toujours plus hautes… et peut-on même les financer ? Inversons la perspective et, pour cela, revenons à la définition du risque : pour qu’il y ait risque, il faut un aléa (l’érosion et la montée du niveau de la mer) et un enjeu exposé à l’aléa (des personnes et des biens). Sans enjeu, plus de risque. Ainsi posé, le problème appelle d’autres solutions, par exemple la dépoldérisation et la renaturation de certaines portions du trait de côte (pensons au concept de «sponge city » du Dr. Kong-Jian Yu) et la relocalisation de certaines habitations et activités. Le défi soulevé par ces réponses est, lui aussi, immense car il pose directement la question du modèle de financement de ces adaptations, particulièrement coûteuses (acquisition de foncier, indemnisation des propriétaires, démolition et déplacement des réseaux…) et du portage de ces coûts. L’étude prospective menée à Lacanau a montré en l’état actuel les coûts prohibitifs d’une stratégie de relocalisation (le déficit d’opération s’élevant à 482 millions d’euros entre 2015 et 2060).
Ce que montre cet exemple, c’est, d’une part, que la connaissance du risque, de l’aléa et des conséquences sur l’enjeu n’est pas suffisante pour déclencher un passage à l’action, que l’on sait pourtant nécessaire. Il montre, d’autre part, la difficulté d’adopter une démarche d’anticipation de long terme plutôt qu’une réaction face à l’aléa, au cas par cas. Il montre enfin la difficulté à penser un modèle alternatif de développement de nos littoraux, tant celui qui a cours aujourd’hui est profitable. La résilience est souvent engagée dans des situations à forte incertitude. Ici, elle l’est dans un contexte de certitude : le défi premier à relever est celui du débat public sur la perte et les coûts associés acceptables. Comme l’explique le glaciologue et spécialiste du changement climatique Michiel Helsen : « à long terme, nous ne pourrons peut-être pas sauver l’ouest des Pays-Bas. Il me semble judicieux que la société discute des parties des Pays-Bas que nous sommes prêts à défendre, et à quel prix ».
Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Sobriété foncière et accès au logement : une nouvelle équation à inventer

Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.